[(- Période historique : le XXème siècle et notre époque
– Thématique : Arts, techniques, expressions
– Sujet : Art, sciences et fascination)]
Pour écouter le début de l’oeuvre intitulée « Pacific 231 » :
Pacific_231.mp3
Une « Pacific 231 »

I – Le compositeur : Arthur Honegger

De nationalité Suisse par ses parents, Arthur Honegger né au Havre le 10 mars 1892, où son père fait commerce du café. Il apprend le violon et s’essaie rapidement à la composition pour jouer aux côtés de sa mère au piano et d’un ami violoniste.
En 1909 il est inscrit au conservatoire de Zurich qu’il quitte en 1911 pour rejoindre celui de Paris.
A 19 ans, il se frotte vite à la vie de la Cité en pleine ébullition culturelle. Tandis que Lucien Capet lui enseigne le violon, il étudie la composition et la direction d’orchestre. Il compose des mélodies, mais aussi un quatuor, avant de quitter le conservatoire en 1918. C’est cette année là que le grand public le découvre.
Arthur Honnegger est influencé tant par Bach ou Beethoven que par Debussy ou encore Stravinsky, et baigne dans un Paris où il côtoie des artistes de renom (Appolinaire, Picasso, Satie, etc.).
Sa musique se pose entre ces tendances artistiques tout en restant, à son image, inclassable.
Au conservatoire, il fait connaissance notamment de Darius Milhaud qui le mènera au Groupe des Six en 1920 avec Francis Poulenc et Germaine Tailleferre.
Le succès arrive en 1921 avec « Le Roi David », puis la célébrité avec « Pacific 231 » en 1923.
Il épouse la pianiste Andrée Vaurabourg en 1926, termine Antigone un an après, avant d’aller aux Etats-Unis présenter ses œuvres. Fort de son succès, il y retourne en 1947. Une crise cardiaque le ramène à Paris et il y décède le 27 novembre 1955.
II – L’oeuvre : « Pacific 231 »
Voici la couverture de la partition réalisée en noir, couleur qui rappelle le charbon.
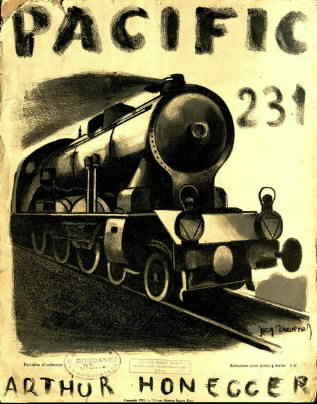
Pacific 231 est le premier des trois mouvements symphoniques écrits par le compositeur suisse Arthur Honegger (1892 + 1955).
Il fut créé en 1923.
Ce projet est issu de la musique d’accompagnement du film La Roue d’Abel Gance.
Il s’agit d’un parcours musical à bord de la célèbre locomotive à vapeur française, la Pacific 231 (formée de deux petites roues à l’avant, trois grandes au milieu et une petite à l »arrière).
Ce mouvement symphonique est considéré comme l’une des premières œuvres musicales dites urbanistes (ou futuristes), c’est-à-dire inspirée par la révolution technologique du début du XXème siècle.
Le succès international de cette oeuvre fut indéniable. Bien que n’étant pas la plus importante de son auteur (elle ne dure que six minutes !), elle a fait le tour du monde et a eu un impact culturel important à l’époque. La Symphonie n° 2, dite « de fer et d’acier » de Sergueï Prokofiev a été inspirée par l’écoute de la création de Pacific 231.
Pacific 231 sera suivi de deux autres mouvements symphoniques :
– Rugby (1928)
– Mouvement symphonique (1933)
III – Analyse de l’oeuvre « Pacific 231 »
Il s’agit d’un parcours musical à bord de la célèbre locomotive à vapeur éponyme.
Le morceau imite divers bruitages grâce aux instruments de l’orchestre symphonique : – grincements de ferraille et fuites de vapeur rendus par les glissandi d’instruments aigus (violons)
– lourdeur du train au démarrage rendue par les instruments graves (cuivres)
– grand bruit de la pleine vitesse (tutti orchestral)
– fracas violent du freinage (percussions)
Il y a de plus un aspect répétitif des bruits de roues à différentes allures.
En effet, Honegger simule :
– l’aspect de rotation par des croches/triolets/ou doubles-croches longuement répétées
– l’accélération du train grâce à des valeurs rythmiques en diminution (valeurs de plus en plus courtes)
– puis la décélération du train par la technique opposée, c’est-à-dire l’augmentation des valeurs rythmiques (valeurs de plus en plus longues).
L’utilisation du bruit dans la musique en tant que recherche maximale des possibilités sonores deviendra progressivement la norme musicale dominante dans la deuxième partie du XXème siècle, surtout dans la musique électroacoustique, qui, par contre, abandonnera les instruments de musique au profit des objets-instruments, des bruits du quotidien et des sonorités électroniques. Pierre Schaeffer réalisera en 1948 une « Etude aux chemins de fer » avec ces procédés électroacoustiques à partir d’enregistrements sur bandes magnétiques.
IV – La locomotive « Pacific 231 »
Les premières locomotives à vapeur datent du début du XIXème siècle. Cette technologie sera utilisée jusqu’aux années 1950 en France mais reste encore employée localement dans certains pays aujourd’hui.
La première Pacific fut française et étudiée dès 1906 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans pour pallier le manque de puissance de l’Atlantic sortie en 1907.
La Pacific 231, sortie en 1922, est formée de deux petites roues à l’avant, trois grandes au milieu et une petite à l »arrière.
Elle consomme 1,5 tonne de charbon aux 100 km et peut atteindre une vitesse de croisière de 100 km/h.
La vidéo d’une « Pacific 231 »
pacific_231.flv
V – Oeuvre complémentaire : « Train en vitesse » de Luigi Russolo
Le peintre italien Luigi Russolo (1885 + 1947) fait partie du mouvement futuriste et s’intéresse beaucoup en musique à l’art des bruits mais aussi à donner l’illusion visuelle en peinture de la vitesse.
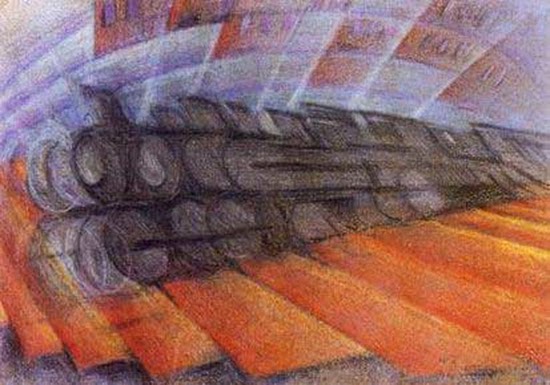
« Train en vitesse » de Luigi Russolo (1912)